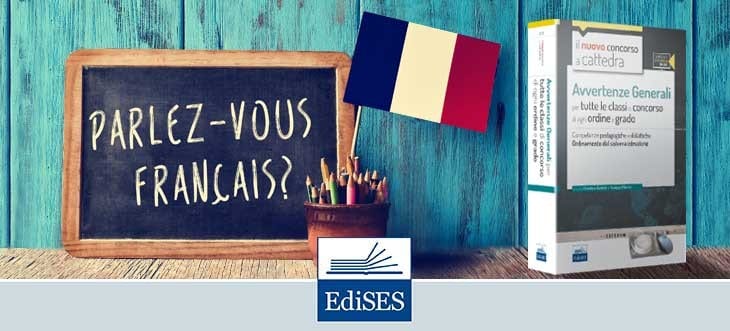Com’è noto, la prova scritta del Concorso a Cattedra 2016 comprenderà l’accertamento delle competenze in lingua straniera di livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.
I candidati avranno la possibilità di scegliere tra lingua inglese, francese, spagnola o tedesca, ad eccezione dei candidati alla scuola primaria per i quali l’inglese è la lingua d’esame obbligatoria. La scelta va comunicata al momento dell’iscrizione.
Non è ancora chiaro se i quesiti in lingua straniera saranno due (come prevedeva la prima bozza dei programmi di studio) o uno solo (come suggerisce il parere espresso dal Cspi), mentre in fase di colloquio orale sembrerebbe confermata l’ipotesi di una domanda in lingua straniera.
A fronte delle tante richieste giunte in redazione, abbiamo pensato di fornire come servizio aggiuntivo e gratuito al nostro manuale sulle Avvertenze Generali, le sintesi in lingua inglese e francese.
Si tratta delle stesse sintesi presenti nel volume alla fine di ogni capitolo: utili per fissare i concetti chiave del capitolo, rappresentano anche esempi di risposte sintetiche e costituiscono dunque un modello di “breve elaborato” per la prova scritta o di “sintetica trattazione” per la prova orale.
Inoltre, in sinergia con Orizzontescuola, abbiamo inaugurato l’iniziativa “Studiamo insieme le Avvertenze Generali”: ogni martedì e giovedì pubblicheremo alcune sintesi dei capitoli del nostro manuale seguite da una breve esercitazione. Su Orizzontescuola è disponibile il calendario del mese di febbraio.
Da oggi è possibile scaricare le sintesi tradotte in lingua inglese e francese dei primi 10 capitoli. Entro il fine settimana, sarà disponibile la seconda parte.
Di seguito un esempio in lingua francese
Chapitre 1 Les théories d’apprentissage et la psychologie de l’éducation.
Le comportementalisme
Le comportementalisme est une théorie de l’apprentissage qui s’est développée dans le domaine de la psychologie, surtout aux États-Unis ; on l’appelle aussi le behaviorisme, de l’anglais ‘ behaviour ‘, qui signifie, justement, comportement.
Le modèle comportemental part de l’idée que l’apprentissage se fait à travers des stimuli S, reçus par le sujet, de par son environnement extérieur.
Atteint par les stimuli, il fournit des réponses R, ou des comportements déterminés. Ce qui se passe dans l’esprit et qui détermine la réponse à un stimulus donné ne fait pas l’objet d’étude; au contraire, le point central de l’observation des comportementalistes est d’essayer d’associer chez un individu une réponse à un stimulus donné, de manière stable.
De cette façon, la réponse du sujet au stimulus est observable et peut être étudiée scientifiquement; si cela est stable, on peut dire que le sujet a appris à réagir d’une certaine manière au stimulus, il y a donc eu une expérience d’apprentissage.
- Les principaux représentants du comportementalisme
Pavlov fut le premier à mener ses recherches sur le lien entre stimulus et réponse, et sur le conditionnement, en distinguant un stimulus et une réponse inconditionnée, d’un stimulus et d’une réponse conditionnée, c’est-à-dire extérieurement induits.
Même l’intérêt de Watson et Thorndike se concentre sur des procédés de conditionnement d’où est tiré l’apprentissage.
En particulier Thorndike qui met en avant l’hypothèse de l’apprentissage à travers les tentatives et les erreurs: afin d’atteindre un objectif déterminé, on va adopter des comportements différents les uns des autres, dans l’ordre et de façon aléatoire, jusqu’à identifier les comportements que l’on considère comme satisfaisants pour arriver à cet objectif.
Skinner décrit deux types de comportement:
- Le comportement répondant, suivant le modèle de stimulus-réponse et qui peut être défini comme un comportement induit par un stimulus externe qui génère une réponse à la question;
- Le comportement opérant, modèle dans lequel le sujet, même sans stimuli spéciaux de l’extérieur, produit un comportement afin de recevoir un effet de récompense que l’on pourrait appeler renforcement positif. Contrairement à celui qui répond, il s’agit d’un comportement actif, puisque le sujet, de sa propre initiative, agit sur l’environnement extérieur pour recevoir un bénéfice.
Albert Bandura a formulé la théorie de l’apprentissage social, d’origine comportementaliste. Grâce à une série d’expériences, Bandura stipule qu’un modèle agressif tend à être justifié et imité par les enfants lorsqu’ils sont dans un état d’irritation.
Ces résultats ouvrent la porte à la notion d’apprentissage par l’observation (ou apprentissage vicariant), un type d’apprentissage qui se détache du paradigme de stimulus-réponse-renforcement et qui a lieu à travers l’observation d’un modèle de comportement.
- La psychologie de la Gestalt
Le mot allemand Gestalt, qui signifie forme ou configuration, se réfère à un courant psychologique, la psychologie de la Gestalt ou psychologie de la forme, qui est née en Allemagne au début du XXe siècle.
Contrairement au comportementalisme, selon ce courant, l’apprentissage est basé sur des processus cognitifs et peut être compris au-delà de l’étude du simple comportement.
Par opposition au comportementalisme de Thorndike, le psychologue Wolfgang Köhler a noté que, en particulier les mammifères les plus proches de l’homme d’un point de vue évolutif, comme les singes anthropomorphes, peuvent apprendre d’une manière différente, à travers une inspiration soudaine, appelée insight (intuition), qui conduit à la résolution d’un problème inhabituel grâce à sa vision globale et complète.
Le psychologue Max Wertheimer revient sur le concept d’insight introduit par Köhler et concentre ses études sur les mécanismes cognitifs qui nous permettent de résoudre des situations jamais rencontrées avant, ou des situations qui ont déjà été présentées dans le passé, mais d’une manière plus immédiate, brillante et efficace.
Il définit la pensée productive comme l’activité mentale qui produit de nouvelles connaissances chez l’individu, par opposition à la pensée reproductive, qui, au contraire, « mécaniquement » nous amène à faire face aux situations déjà vécues ou nouvelles, avec les mêmes vieilles solutions, sans cadrer le problème d’une manière originale.
- Le Human Information Processing
Human Information Processing, abrégé HIP, peut être traduit en italien comme le «Traitement de l’Information chez les Humains». Il s’agit d’un courant psychologique qui étudie l’esprit humain et les processus qui le concernent, selon une analogie étroite avec les ordinateurs.
Le modèle multi-entrepôts décrit le fonctionnement de l’esprit humain en utilisant un système de trois entrepôts ou des souvenirs qui s’échangent des informations.
La mémoire sensorielle (MS) est en contact avec l’environnement extérieur et c’est de là qu’elle reçoit des stimuli; un premier traitement dans le registre sensoriel permet de sélectionner seulement quelques caractéristiques du stimulus, qui sont reportées dans la mémoire à court terme (MCT), appelée aussi mémoire de travail (MT).
Ensuite, il y a un transfert dans la mémoire à long terme, qui est censée être dotée d’une capacité illimitée, dans laquelle les informations et les programmes peuvent être contenus pendant de très longues périodes.
- La métacognition
L’activité métacognitive est une activité d’auto-réflexion qui accompagne l’activité cognitive et a pour objectif de la rendre plus consciente, de la contrôler et de l’évaluer afin de garantir un apprentissage plus efficace. La première phase de l’activité métacognitive consiste à comprendre la nature de la tâche à accomplir : à cette phase s’ajoute la méta-compréhension.
Si la compréhension signifie comprendre ce qui est en jeu, la méta-compréhension est une activité qui consiste à évaluer consciemment le niveau de compréhension de la tâche.
Le passage successif à la compréhension (et à la métacompréhension) de la tâche à accomplir est le choix d’une stratégie. Lorsqu’il est question de choix de la stratégie, on se réfère à l’étude de la métamémoire, c’est-à-dire la capacité de connaître la mémoire.
En particulier, l’on tient compte du fait que dans le déroulement d’une tâche, dans la mise en œuvre d’une stratégie, entre les différentes aptitudes, il convient également de faire usage de la mémoire, en faisant appel à des données qui ont été mémorisées avant la tâche ou bien qui sont mémorisées durant celle-ci.
- Le constructivisme
Le constructivisme suggère une série de structures psychiques qui permettent de construire une façon personnelle d’interpréter la réalité. Chaque individu, grâce à sa vision personnelle de la réalité, peut la décoder et lui donner un sens, en apprenant, par conséquent, en interagissant avec l’environnement.
Celle-ci a lieu par l’intermédiaire d’un échange continu d’informations qui permettent à l’individu de trier la réalité de la façon qui lui semble la plus fonctionnelle.
On distingue différents types de constructivisme:
- Le réalisme limité (ou réalisme critique), selon lequel il existe une réalité externe objective qu’il est possible de connaître de façon directe;
- Le constructivisme épistémologique, dont le paradigme est l’existence d’une réalité externe indépendante de l’observateur, laquelle est inconnaissable par celui-ci, sinon à travers un processus de construction de cette dernière;
- Le constructivisme herméneutique. Dans ce cas, on ne croit pas en l’existence d’une réalité indépendante, objective et externe à l’individu. La connaissance est le fruit de la médiation du langage et de l’interaction entre divers observateurs.
Les trois approches diffèrent aussi bien sur le plan ontologique, relatif à l’existence de la réalité, que sur le plan épistémologique, concernant la possibilité de connaître la réalité grâce à la méthode scientifique.